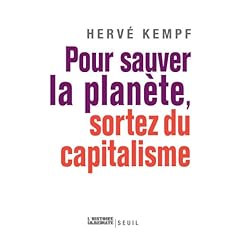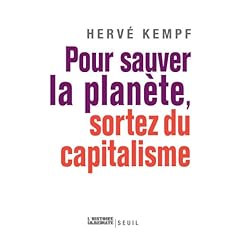En parlant de riches / super riches / solidarité etc... J'ai fini il y a quelques jours ce bouquin

C'est écrit par Herve Kempf, un journaliste du Monde spécialisé dans les questions environnementales et plutôt proche de la gauche alter (pour faire court).
Dans ce bouquin il revient sur la crise écologique en en présentant les caractéristiques les plus marquantes. Il développe ensuite la question de la montée (ou remontée) des inégalités que ce soit au sein des sociétés développées ou entre pays. Il montre que les deux s'imbriquent assez bien, avec une double peine pour les pauvres qui est de subir le plus fortement les conséquences de la crise écologique.
Mais le coeur du bouquin c'est le titre qui le définit. Il pointe la responsabilité des plus riches dans l'absence de (volonté de) réaction face aux problèmes écologiques.
Il ne s'agit pas de montrer à quel point un "riche" pollue plus par son mode de vie qu'un "pas riche". C'est clairement le cas mais vu les volumes respectifs c'est pas ça qui change la donne.
En fait il s'appuie sur deux éléments principaux pour expliquer la responsabilité des riches dans la catastrophe actuelle.
D'une part il fait appel aux théories d'un économiste assez intéressant,
Thorstein Veblen (que les étudiants en économie connaissent via ce qu'on appelle les biens de Veblen). En l'occurrence il reprend la théorie de la consommation ostentatoire :
Esprit extrêmement caustique, il s'intéressa à la partie cachée de l'iceberg économique : les motivations des acheteurs. Considérant la classe à l'abri des besoins matériels immédiats et de la contrainte du travail autre que souhaité (la classe de loisir, ainsi la nomme-t-il), il y trouva essentiellement la vanité et le désir de se démarquer de son voisin. Il note que par sa consommation l'élite gaspille du temps et des biens. Elle fait du gaspillage du temps, soit le loisir, et du gaspillage des biens, soit la consommation ostentatoire, ses priorités. Par exemple, une de ses pages inoubliables dans sa Théorie de la classe de loisir (1899) concerne le lustre de l'étoffe, prisée dans les chapeaux car servant à montrer qu'on les change souvent, et considéré défavorablement pour les pantalons parce qu'il montre qu'au contraire on ne l'a pas changé depuis longtemps. Alors qu'il s'agit du même lustre ! Il n'y a donc pas selon lui d'esthétique dans l'affaire, mais simplement une émission de signifiants de puissance qui est la raison d'être de la consommation ostentatoire (conspicuous consumption). Ce concept est fondateur en sociologie et on le retrouve sous une forme ou une autre dans la sociologie de Pierre Bourdieu, de Robert K. Merton et dans une autre mesure dans l'œuvre de Jean Baudrillard.
Il l'utilise pour expliquer que dans le contexte de mondialisation actuel le mode de consommation des élites occidentales devient le modèle à suivre non seulement des "non riches" occidentaux mais de l'ensemble de la population mondiale. Or il génère un gaspillage généralisé, la plus grande part de la consommation servant à cette distinction. En outre vu l'impact de cette question de la distinction impossible de demander aux "pauvres" de ne pas vouloir faire comme les riches tant que ces derniers ne calment pas un minimum leurs orgies de distinction...
Dans un deuxième temps il montre que les élites ont tout intérêt à maintenir l'illusion d'un besoin de croissance de la production matérielle car c'est le seul moyen de ne pas avoir à se poser la question d'une plus juste répartition des richesses. Tant que la croissance permet de hausser même un peu le niveau de vie des pauvres ils peuvent continuer de se vautrer dans un luxe insensé. Cette croissance est la soupape qui permet de ne pas avoir besoin de remettre en cause fondamentalement la distribution de la richesse.
Enfin il revient sur l'impact de cette situation (qui commence à craquer vu que la croissance ne réduit plus que très marginalement voire pas du tout la pauvreté et n'a aucun impact sur les inégalités, au contraire) sur le jeu démocratique en étendant le raisonnement à la question de l'avenir de la démocratie. Il y parle donc de la l'usage de l'alibi terroriste pour accroître le contrôle de la population, de la gestion pénale et sécuritaire des conséquences de la déréglementation sociale, etc...
Le bouquin se lit assez vite, il y a de nombreux exemples, c'est assez vivant et bien structuré, bref c'est un plaisir à lire.
Après la double thèse peut paraître un peu exagérée. A titre personnel je la trouve d'une rare justesse même si, dans le détail, elle révèle forcément des faiblesses. Mais ce n'est pas non plus une thèse...
Là j'attaque le second bouquin de cet auteur :